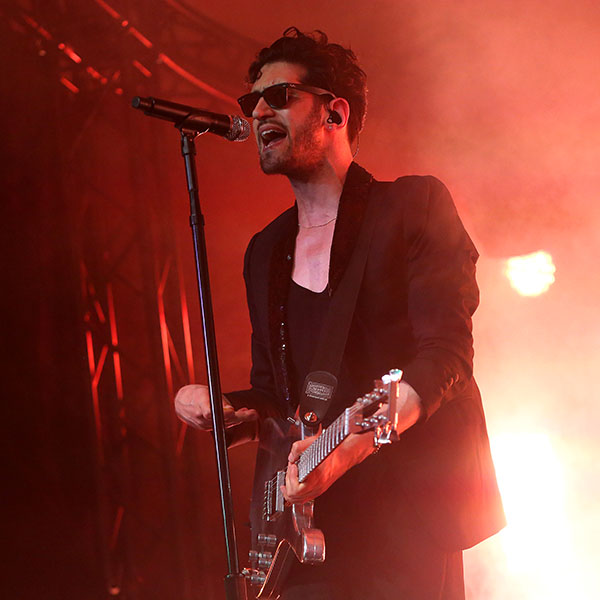Si vous donnez rendez-vous à Laure Waridel [B.A. 1996] dans un café, assurez-vous qu’on y propose du café ou du thé équitable. Car, pour la cofondatrice d’Équiterre et autrice de Acheter, c’est voter, et de L’Envers de l’assiette, le moindre grain de café, la moindre poche de thé sont chargés d’enjeux symboliques et économiques ayant des répercussions en matière d’environnement, d’équité et de justice sociale.
« L’humanité a fait de gros dégâts, des espèces ont disparu, on n’effacera pas toutes nos émissions de GES et on a laissé la mondialisation ériger la cupidité en système. Mais je pense qu’on pourrait faire des miracles en canalisant tout le savoir en quelque chose de positif », dit la sociologue et professeure associée à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM.
Laure Waridel s’est fait un nom très tôt dans la mouvance écologiste et solidaire québécoise. En 1993, en première année de sociologie à l’Université McGill, elle n’avait que 20 ans lorsqu’elle se joint à un groupe d’étudiants animés des idées du mouvement mondial ASEED, acronyme d’Action pour la solidarité, l’équité, l’environnement et le développement.
Ils fondent la section locale d’ASEED, rebaptisée Équiterre cinq ans plus tard, et désormais l’une des principales références québécoises en la matière. « J’adorais cette approche-là », raconte Laure Waridel, qui en était la porte-parole jusqu’en 2006. « Dénoncer, oui, mais il faut aussi agir et proposer des solutions. »
À 52 ans, elle admet n’avoir jamais été aussi inquiète pour la justice sociale et l’environnement. Mais, même face au fort vent contraire du trumpisme, du populisme et du climatoscepticisme, elle croit possible le retour du bon sens.
« Le problème est connu des scientifiques depuis longtemps. L’alarme sonne depuis 1972. Toutes les prédictions du GIEC se réalisent, et même plus tôt que prévu. »
Laure Waridel
Après tout, rappelle-t-elle, c’est un premier ministre conservateur, Brian Mulroney, qui a été l’un des instigateurs de la lutte politique aux changements climatiques avec le protocole de Montréal sur la couche d’ozone de 1997 et l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air de 1991. « Ce sont deux exemples probants où des politiciens ont écouté les scientifiques et établi des règles adéquates. Alors, oui, c’est possible, quand il y a une compréhension des problèmes et une volonté politique d’agir. »
Ayant assisté à sa première conférence sur les changements climatiques dès 1990, elle récuse tout scepticisme en la matière. « Le problème est connu des scientifiques depuis longtemps. L’alarme sonne depuis 1972. Toutes les prédictions du GIEC se réalisent, et même plus tôt que prévu. À certains égards, le GIEC est même un peu conservateur par rapport à la réalité. »
L’écologisme scolaire
Si elle est un peu l’égérie du mouvement environnementaliste et solidaire québécois, Laure Waridel explique que ses propres convictions remontent à ses années de polyvalente. À l’époque, elle participait au Club 2/3, un OBNL qui se voulaient le rendez-vous québécois de la jeunesse engagée. Au cégep de Sainte-Thérèse, l’étudiante milite à la fois dans l’association étudiante, dont elle sera présidente, et dans le mouvement écologiste, qui met en place le premier programme de recyclage dans l’établissement.
Elle explique être un pur produit de la mouvance pour l’éducation relative à l’environnement (ErE), animée par des pédagogues, des didacticiens et des syndicalistes regroupés au sein de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement. « C’est un secteur où les Québécois ont joué un rôle de pionniers dès la fin des années 1970. »
Laure Waridel n’a jamais appartenu à une jeunesse dorée qui l’a eu tout cuit dans le bec, bien au contraire. Née en Suisse de parents agriculteurs qui ont immigré peu après, elle a grandi sur une ferme de 30 vaches au fond d’un rang à l’ombre du mont Saint-Grégoire, en Montérégie. « On était une famille modeste, ma mère cousait nos vêtements et tenait un potager. »
Son premier contact avec l’école aura été difficile, marqué par de profonds troubles d’apprentissage dont elle s’est longtemps ressentie. « J’avais été peu exposée à la société québécoise. Soudain, le gros bus jaune débarque, je ne comprenais pas ce qui se passait, et j’étais dyslexique. »
Grâce à un solide soutien en orthopédagogie et en orthophonie, elle a repris confiance en elle-même. Mais même si elle a pu fréquenter les classes enrichies du secondaire, elle lit encore très lentement. Rêvant de faire du développement international, elle a choisi de fréquenter l’Université McGill pour l’anglais. « Mais avant d’entrer à l’université, je suis partie huit mois en Angleterre pour apprendre cette langue, mais j’en ai arraché avec les manuels en anglais. »
À McGill, elle fait plusieurs rencontres décisives, dont le sociologue de l’environnement Roger Krohn. « J’ai encore une plante qui était une de ses boutures. Je me rappelle avoir pleuré dans ses cours devant l’ampleur de l’empreinte environnementale des humains et son caractère destructeur, mais aussi parce qu’il me faisait comprendre la très grande complexité des processus. »
Grâce au géographe de l’environnement Thom Meredith, elle part effectuer un projet de recherche indépendant sur le commerce équitable au sein d’une communauté productrice de café à Oaxaca, au Mexique.
Cette expérience et ses suites la révèlent d’abord parmi les environnementalistes et ensuite auprès du public. Son essai d’étudiante, qu’elle recycle un petit livre de 71 pages intitulé Cause Café, sert de cadre aux premières grandes activités d’Équiterre. « Grâce à une subvention de 20 000 dollars d’Oxfam, nous en avons fait une BD, une pièce de théâtre, une trousse pour étudiants, qui ont donné lieu à des participations dans des groupes de recherche, à des conférences dans les universités, en plus de nombreuses entrevues médiatiques. Oxfam en a vraiment eu pour son argent. »
Ce côté entreprenant est une constante dans toute la carrière de Laure Waridel, notamment par sa capacité de décliner ses propres travaux en multiples facettes. Son succès de librairie, Acheter c’est voter, porte le titre de sa première chronique radio-canadienne, qui l’a fait connaître du public. Et plus tard, sa thèse doctorale en anthropologie et sociologie du développement à l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève servira de base pour un autre livre, « La transition, c’est maintenant. »
Cultiver son jardin
Actuellement, Laure Waridel tient une chronique hebdomadaire dans le Journal de Montréal et siège, entre autres, au conseil d’administration de l’École de l’environnement Bieler de l’Université McGill et de Mères au front. Cet organisme, dont elle a été l’instigatrice avec la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette, rassemble des mères et des grands-mères engagées dans des activités de mobilisation visant à amener les gouvernements à prendre des décisions qui engagent l’avenir des enfants.
En parallèle, Laure Waridel se lance dans un projet plus personnel, appelé Le Jardin des possibles. Elle et son mari, l’avocat montréalais Bruce W. Johnston [B.A. 1988, B.C.L. 1992, LL.B. 1992], ont acheté une vaste terre de 100 hectares voisine de leur maison de Frelighsburg afin de créer un centre d’activités pour personnes neuroatypiques.
L’idée part des problèmes que vit sa fille de 20 ans, Alphée, atteinte d’une maladie génétique rare, le syndrome de Smith-Lemli-Opitz, qui entraîne des déficiences intellectuelles et physiques. « Le soutien de l’état cesse à 21 ans, ce qui est un non-sens. C’est souvent une catastrophe pour les familles qui doivent solliciter des organismes de bienfaisance ou communautaires. »
Le couple vise à favoriser le contact et l’insertion sociale à travers des activités, tels l’entretien d’animaux et de potager, ou la transformation alimentaire. La grande particularité du Jardin des possibles sera de s’adresser à tous les types de clientèles neuroatypiques (déficience intellectuelle, maladie mentale, déficit neurocognitif, etc.), plutôt qu’à un seul, comme cela se fait habituellement ailleurs.
« Ça peut sembler très utopique, mais nous croyons que c’est possible, convient Laure Waridel, on verra bien si c’est faisable. »